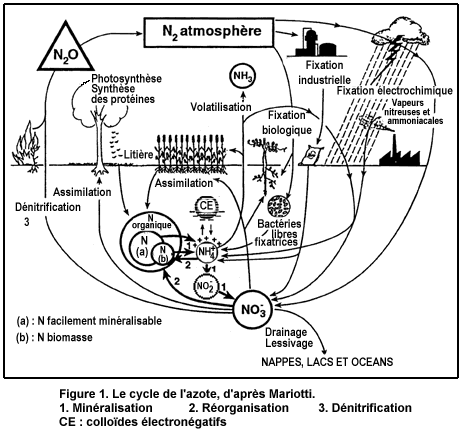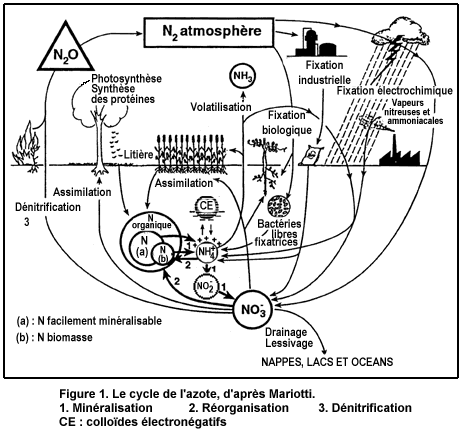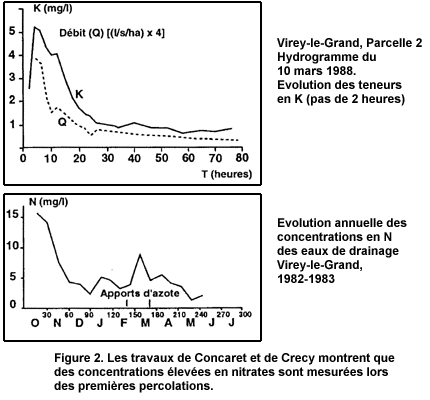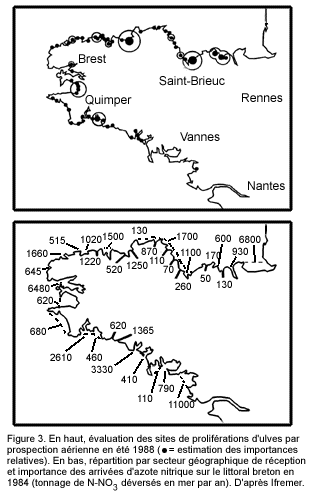Christian BUSON
De nos jours, les nitrates font l'objet d'un
consensus général. La réglementation sur l'eau potable, les programmes de "
reconquête " de la qualité des eaux, les investissements prévus sur les ouvrages
d'épuration, les mises aux normes des exploitations agricoles, tout est
essentiellement conduit en vue d'un objectif suprême et apparemment incontesté :
la baisse des taux de nitrates dans les milieux et, en particulier, dans l'eau.
Il paraît utile, alors que des sommes considérables doivent encore être
investies dans ce but, d'examiner, à la lumière des connaissances actuelles, le
rôle exact de cet anion vis-à-vis de notre santé et de notre environnement, puis
de tenter une synthèse à propos des nitrates.
Nitrates et santé
Les nitrates sont utilisés depuis des temps immémoriaux pour la conservation
des aliments à des doses élevées : plusieurs grammes par kilo de viande ou de
poisson à conserver.
Dans l'histoire, les nitrates ont été utilisés à fortes
doses (supérieures à plusieurs grammes par jour) comme médicaments pour diverses
affections (J. et J.L. L'hirondel, 1996). Aujourd'hui, de nombreux médicaments
ont dans leur composition des sels nitratés ou des dérivés nitrés. Ainsi, la
trinitrine est-elle très largement prescrite dans le traitement et la prévention
de l'angine de poitrine ; de même, des gels dentaires contiennent du
nitrate de potassium (à 5% de nitrate).
Les nitrates sont particulièrement
et naturellement abondants dans la plupart des légumes (500 à 3 500 mg de NO3
par kilo de MS) et cela ne gêne en rien leur consommation. Celle-ci est vivement
recommandée par tous les nutritionnistes et les études épidémiologiques
confirment l'intérêt de la consommation régulière de légumes pour la protection
sanitaire des populations contre diverses affections et, en particulier, pour
prévenir et limiter les différentes formes de cancer. Si les nitrates
présentaient la moindre toxicité, de tels résultats ne seraient pas observés
avec les régimes à base de légumes.
Face à l'objection attribuant les effets
bénéfiques des légumes à leurs seuls composés organiques, il serait facile de
répondre que la consommation régulière de légumes éliminerait alors tous les
risques supposés des nitrates.
Les nitrates ne sont généralement plus
considérés comme toxiques en tant que tels - c'est l'éventuelle transformation
des nitrates en nitrites puis leur combinaison avec les amines (nitrosamines)
qui est en général mise en avant pour maintenir la suspicion à l'égard des
nitrates.
Concernant la dangerosité des nitrites, nous pouvons
apporter les arguments suivants (J. et J.L. L'hirondel, 1996) :
- La réduction des nitrates en nitrites est le résultat d'une transformation
bactérienne qui dépend de plusieurs facteurs de milieu et qui nécessite du
temps. Autrement dit, cette réduction s'effectue plus difficilement que la
simple écriture de la réaction ne le laisserait supposer. En outre, les
réactions se poursuivent au-delà du stade des nitrites, de sorte que
l'accumulation de nitrites est relativement rare et que les concentrations en
nitrites restent faibles dans les organismes.
- Les nitrites ne sont toxiques que pour le nourrisson avant 6 mois en
raison de la moindre activité de la méthémoglobine-réductase. Les nitrites
absorbés en grande quantité par le jeune nourrisson provoquent alors une
affection particulière - la méthémoglobinémie - qui à partir d'un certain
stade peut entraîner une cyanose. Cette affection a quasiment disparu dans les
pays occidentaux. Passé cet âge de 6 mois, le nourrisson dispose d'un système
enzymatique assez efficace pour faire face aux ingestions courantes de
nitrites. Aucun effet des nitrites n'est plus à craindre après 6 mois, que ce
soit par ingestion directe ou après transformation des nitrates (exogènes ou
endogènes) en nitrites.
- Les nitrates ingérés par les nourrissons ne provoquent jamais de
méthémoglobinémie, seule l'ingestion directe de nitrites préformés avant
l'ingestion par le nourrisson est responsable de ce trouble. Dans
l'organisme du nourrisson, la transformation des nitrates ingérés en nitrites
est infime de telle sorte qu'aucun risque n'existe dans la consommation par le
nourrisson d'aliments riches en nitrates tels que les soupes ou des
préparations à base de légumes (carottes, épinards, etc.). La soupe de
carottes est d'ailleurs abondamment consommée et même préconisée pour
combattre ou prévenir des épisodes diarrhéiques des nourrissons.
- De simples mesures d'hygiène élémentaire suffisent à éviter les
pullulations bactériennes à l'origine de toute transformation des nitrates en
nitrites préalablement à l'ingestion par le jeune nourrisson. Il faut
veiller en particulier à utiliser une eau indemne de contamination en agents
pathogènes (après ébullition notamment), à nettoyer correctement les
récipients et les ustensiles et, surtout, à réduire le délai entre la
préparation et la consommation des aliments. Ainsi, la prévention de la
méthémoglobinémie (affection rarissime aujourd'hui) portera essentiellement
sur les conditions de préparation des aliments (hygiène, délais, etc.) et, en
aucune manière, sur la teneur en nitrates de l'eau ou des ingrédients.
- Les nitrites ingérés par la mère ne sont pas dangereux pour le foetus car
celui-ci est protégé par les enzymes maternelles. Il est donc inutile de
recommander une quelconque modération de consommation de nitrites à la femme
enceinte.
- Les nitrites sont aussi utilisés traditionnellement dans la conservation
des viandes et des poissons. Leur usage est réglementé et autorisé jusqu'à
plusieurs centaines de milligrammes par kilo de produit soumis à dessiccation.
Les nitrites ne présentent aucun danger à ces doses modérées ni pour le
nourrisson passé 6 mois, ni pour l'enfant, ni pour l'adulte, ni pour la femme
enceinte, ni pour les personnes âgées, ni pour les personnes malades ou
affaiblies. En tout état de cause, aucune ingestion de nitrates ne peut
provoquer d'empoisonnement de l'organisme après transformation des nitrates en
nitrites.
- Les nitrosamines éventuellement produites à partir des nitrates ingérés
représentent des quantités infimes comparées aux quantités habituellement
rencontrées dans de nombreux aliments ou dans notre environnement (J. et J.L.
L'hirondel, 1996). Vouloir bannir les nitrates de notre alimentation au motif
qu'une quantité infime est susceptible de former des nitrosamines est donc
déraisonnable. L'élimination de toute trace de nitrosamine de notre
environnement est absolument irréaliste et n'a d'ailleurs jamais été
envisagée.
- Le risque de cancers induits par les nitrites et les nitrates n'a jamais
pu être établi, bien au contraire, et peut être considéré comme
négligeable.
En conséquence, les risques dus aux nitrates, par suite de
leur éventuelle transformation en nitrites ou en nitrosamines dans
l'organisme, peuvent donc être définitivement écartés.
Les nitrates ne
provoquent que des effets bénéfiques pour la santé. Ils contribuent à la
protection sanitaire par leur action à l'égard de nombreux agents pathogènes :
bactéries, champignons, etc., (voir les travaux de l'équipe de N. Benjamin et
al., 1994, 1995, 1996).
L'organisme utilise constamment les nitrates,
qu'ils soient d'origine alimentaire (exogènes) ou endogènes. De plus, dans de
nombreuses affections, l'organisme réagit en libérant une quantité accrue de
nitrates. Le rôle essentiel joué par le monoxyde d'azote (NO) dans l'activité
cellulaire explique cette présence de nitrates.
L'application des critères
toxicologiques à l'égard des nitrates (J. et J.L. L'Hirondel, 1996), outre
qu'elle est inappropriée s'agissant ici d'un composé non toxique, a été menée
à l'origine à partir d'une publication imprécise de Lehman (1958) : une dose
sans effet (DSE) a ainsi été évaluée sans vérification des effets de doses
supérieures. C'est notamment ce que Maekawa a expérimenté en 1982 lorsqu'il a
mis en évidence que des doses cinq fois plus élevées restaient également sans
effet négatif pour leurs consommateurs. La dose maximale sans effet n'a pas
été déterminée. Il en résulte que la dose journalière admissible (DJA)
pourrait au moins être multipliée par cinq, et ainsi la norme sur l'eau
potable qui est sensée en être déduite pourrait passer de 50 mg à 250 mg de
NO3 par litre au minimum.
Pour conclure, ni les nitrates ni
leurs dérivés dans l'organisme ne peuvent donc plus être considérés comme
toxiques, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Ainsi,
Apfelbaum (1998) confirme que " la consommation de nitrates est inoffensive
chez l'homme sans limite de dose ".
Nitrates, sol et plantes
cultivées
Les nitrates constituent l'une des formes de l'azote, élément indispensable
au développement de toute vie végétale et animale (Addiscott et al., 1991). Le
cycle de l'azote dans le sol comprend normalement la forme nitrique (voir figure 1,
Mariotti, 1996).